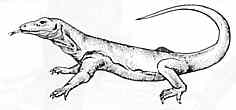
Rencontre des élèves du Réseau Clipperton Auxerre avec Ivan Ineich, herpétologiste icaunais, de retour de Clipperton.
(jeudi 17 mars 2005 14h-16h, collège A. Camus-Auxerre)

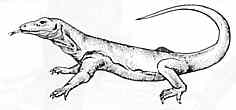 |
Rencontre des élèves du Réseau Clipperton Auxerre avec Ivan Ineich, herpétologiste icaunais, de retour de Clipperton. (jeudi 17 mars 2005 14h-16h, collège A. Camus-Auxerre) |
|
Public : les élèves du Réseau Clipperton Auxerre (RCA).
- Elèves de l’atelier scientifique du collège Albert Camus – Auxerre- (8 élèves de 3ème ).
- Elèves de l’atelier scientifique du collège Jean Roch Coignet -Courson les Carrières- (12 élèves de 4ème).
- Elèves du lycée Jacques Amyot –Auxerre- (3 élèves de 1ère S en TPE).
Organisation :
1. Présentation du réseau –M. Dargent (5 minutes).
Les trois établissements auxerrois travaillent en réseau et l’intérêt de ce dispositif tient dans les échanges et les actions communes réalisées.
2. Présentation de chaque groupe d’élèves et des responsables (M Banton, Mme Dargent et M Dargent) : travaux en cours (15 minutes).
Le collège JR Coignet de Courson les Carrières a expliqué la démarche de terrain et de récoltes d’échantillons qu’il a menée. Une comparaison avec le travail fait à Clipperton a pu être établie.
Le lycée J. Amyot a présenté son travail sur la modélisation mathématique des motifs des poissons tropicaux et a souligné l'intérêt des échanges avec les équipes de scientifiques (Equipe du professeur De Kepper à Bordeaux et équipe de Jean-Louis Etienne à Clipperton).
Le collège A. Camus a exposé sa problématique (espèces introduites) avec la démarche originale de réalisation de maquette de champignon géant.
3. Présentation d’Ivan Ineich (30 minutes).
Ivan Ineich a exposé le but et les résultats de son travail à Clipperton. Il a observé deux espèces de lézards, l’une endémique (présente uniquement à Clipperton car arrivée naturellement depuis très longtemps -Emoia arundeli.-) et une autre (Gehyra mutilata), introduite très récemment (50 ans) que l’on retrouve en Polynésie Française.
Son exposé a également explicité son travail sur les reptiles et en particulier les serpents marins, en faisant référence à d’autres missions. Le travail sur le terrain et les conditions de vie à Clipperton ont également été relatés.
L’intégralité de la séance a été filmée par M. Joliton, responsable vidéo au CDDP d’Auxerre et l’ensemble des échanges est retranscrit ci-dessous.
|
|
Présentation de la mission Clipperton par Ivan Ineich |
Claude Joliton en train de filmer l'intervention |
|
|
Explications sur les serpents marins |
Explications sur la répartition des lézards à Clipperton |
Retranscription de l'intervention d'Ivan Ineich
"Devenu chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle en 1988, j'étudie les reptiles, je suis herpétologiste. J'ai réalisé une thèse en 1987 sur les reptiles terrestres de Polynésie française. Sur les 120 îles de Polynésie, j'ai essayé de comprendre comment sont arrivés ces lézards et comment ils se sont disséminés d'une île à l'autre. Dans ce cadre-là, pour moi, aller à Clipperton, c'était une opportunité car cette île est très éloignée de la Polynésie. Seulement, cette île est très difficile d'accès. J'avais bien vu quelques lézards auparavant dans des Muséums puisque avant cette expédition, plusieurs scientifiques étaient venus à Clipperton et en particulier une botaniste qui a réalisé un travail de monographie physique et biologique de l'Ile. Elle a fait des inventaires mais qui sont incomplets car elle n'y a séjourné que 3 semaines. Par contre, il n'y a jamais eu de spécialistes de reptiles sur Clipperton bien que des reptiles aient été ramassés au cours d'autres missions. Souvent les scientifiques, à l'occasion de leurs travaux sur les oiseaux ou les plantes, ramènent des reptiles qu'ils ont pu trouver. J'ai vu ces spécimens (une dizaine en tout) qui ont été ramassés, en 1897 pour les plus anciens, et en 1970 pour les plus récents. Cependant, le fait d'aller sur place m'a permis de faire des découvertes intéressantes à propos de ces lézards-là.
En Polynésie, j'ai étudié les lézards en observant les variations morphologiques des spécimens : la taille, la couleur et le nombre d'écailles. J'ai trouvé que les 9 espèces de lézards étaient identiques dans toute la Polynésie. En fait ces lézards passent très facilement d'une île à l'autre. Ils n'évoluent pas car ils ne sont jamais isolés, avec des déplacements de lézards en permanence. Pour qu'une espèce puisse évoluer, il faut qu'elle soit isolée par une barrière géographique, par exemple une montagne. Les deux populations d'une même espèce, isolées par le relief, vont alors évoluer différemment pour donner chacune, au bout de plusieurs générations, une nouvelle espèce (spéciation).
Parfois, à la suite de cyclones, des morceaux d'îles sont arrachés, avec de la végétation et des animaux. Ces radeaux flottants vont être transportés sur l'océan. 99999 sur 100000, le radeau se perd dans l'immensité de l'océan et tous les organismes meurent. Seulement 1 fois sur 100 000, ce radeau arrive sur une autre île. Les êtres vivants du radeau vont alors pouvoir s'installer. Ces espèces occupent l'île sans l'intervention de l'homme. On appelle cela une colonisation naturelle et l'espèce n'est pas qualifiée d'envahissante. Les îles océaniques, nées au milieu de l'océan d'une activité volcanique, sont colonisées par des organismes provenant des radeaux flottants, de courants, de bateaux, ou même par les vents. A 10000 m d'altitude, les scientifiques ont même capturé des araignées qui, emportées par les vents jusqu'à cette altitude ont pu retomber sur une île et la coloniser.
Deux espèces de lézards coexistent à Clipperton Emoia arundeli. et Gehyra mutilata. Emoia cyanura de Polynésie vit toujours dans la végétation, en particulier dans les cocoteraies. Dans un lieu sans végétation comme à Clipperton, ce lézard vit dans le corail mort. Il est probablement arrivé de Polynésie sur Clipperton depuis très longtemps, avant qu'il y ait de la végétation sur l'atoll. Comme il n'y avait rien, ce lézard a eu deux possibilités : soit il disparaissait, soit il s'adaptait en vivant dans le corail mort. Il a su s'adapter en vivant dans le corail mort, et ce, uniquement à Clipperton. Le même scénario s'est produit pour son alimentation (changement de son régime alimentaire). Partout ailleurs dans le monde, il s'alimente de crustacés, comme les gammares que vous avez étudiés à Auxerre. Or à Clipperton il n'y a pas de gammares. Et en ouvrant l'estomac d'un de ces lézards, j'ai eu la surprise de découvrir 16 tiques d'oiseaux! C'est la première fois qu'un lézard "vampire" se nourrissant de tiques pleines de sang d'oiseaux est décrit. Son alimentation, son habitat et sa couleur beaucoup plus sombre, mélanique, que celle de Polynésie, permettent de valider cette nouvelle espèce présente uniquement à Clipperton, une espèce endémique. La seconde espèce de reptiles, un gecko, n'a été signalée qu'en 1957, probablement introduite sur Clipperton par un bateau provenant du Mexique. C'est une espèce introduite mais pas envahissante. On appelle espèce envahissante une espèce qui perturbe l'homme ou l'écosystème. Des espèces introduites, il y en a des milliers chez nous : les poires, les pommes, les roses, les cerises. Si on enlevait les espèces introduites de la région d'Auxerre, les 3/4 des espèces seraient à éliminer. Le gecko introduit à Clipperton n'est pas pour autant une espèce envahissante car il n'y avait pas d'autre gecko sur l'île. Ce nouveau gecko n'a donc pas pu interférer avec une espèce endémique."
|
4. Les échanges avec les élèves (50 minutes)
L’organisation et les objectifs de la mission
1. En quoi consiste le travail du chercheur sur le terrain ? Quelle est l’organisation de la journée type du chercheur ? (récoltes, prises de notes…)
Le travail type sur le terrain à Clipperton est assez inattendu voire imprévisible en raison de son isolement et de la méconnaissance des contraintes locales (marées, climat).
Des paléo-climatologistes (spécialistes du climat) ont prélevé des carottes de corail pour analyser le rythme de croissance du corail. En datant les stries du corail ils peuvent déterminer son âge. Mais au moment de commencer les forages, des pannes, sans pièces de rechanges disponibles sur place les font changer d'organisation ou s'improviser bricoleurs.
Ainsi, il était prévu de sortir à chaque marée -soit au moins 2 sorties par jour- pour récolter des échantillons. En réalité, seule une marée avait une amplitude suffisante pour pouvoir sortir du lagon, réduisant d'autant les récoltes.
Des dispositifs astucieux ont été trouvés par les chimistes ; par exemple ils ont prélevé de l'eau du lagon avec des bouteilles particulières qui s'ouvrent depuis la surface avec une petite trappe leur évitant de plonger. Les échantillons récoltés sont recueillis dans des flacons, soigneusement étiquetés en notant des paramètres de terrain, la turbidité de l'eau, sa température, sa profondeur, …De retour en laboratoire, ils peuvent analyser la chimie (pH, nitrates) des échantillons.
Concernant mon travail, j'ai exploré Clipperton à la recherche de nouvelles espèces de reptiles. Le serpent dit des pots de fleur, présent dans les îles de Polynésie et au Mexique, est absent de Clipperton. Il faut néanmoins se méfier : quand on trouve une espèce à un endroit, on peut dire qu'elle existe, mais quand on ne la trouve pas, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas présente, il se peut qu'on ne l'ait pas encore trouvée.
2. Y a t-il des échanges d’informations entre chercheurs de spécialités différentes ?
Les recherches font appel à de nombreux champs disciplinaires, nécessitant une collaboration entre chercheurs. Concernant les lézards de Clipperton, je collabore avec des acarologues (spécialistes des acariens) et des ornithologues (spécialistes des oiseaux), pour leur demander les précisions sur les modes de vie des tiques mangées.
Nous avions également un moment d'échange chaque soir sur Clipperton au bar des fous , les fous, les oiseaux… et les chercheurs venus explorer cet îlot!
Au cours des plongées, des observations générales sont rapportées aux différents spécialistes. Actuellement, la recherche s'organise autour de missions et de travaux d'équipes car c'est très enrichissant. Certains spécialistes sortent la nuit d'autres le jour, dans des endroits très différents et ces échanges permettent d'optimiser les observations scientifiques.
|
Voir la vidéo "coordination scientifique" |
3. L’équipe de JLE revient en avril, est-t-il prévu un nouveau séjour à Clipperton en 2006 ? si oui dans quels buts ?
Pour le moment il n'est pas prévu un nouveau séjour sur Clipperton mais de faire de cette île un observatoire des océans. D'autres missions s'y dérouleront probablement mais il faut trouver le financement de ces missions qui coûtent très cher. D'autres grosses missions sont en projet dans d'autres régions du monde.
Le travail spécifique d’Ivan Ineich
4. Pourquoi avez-vous été choisi pour aller à Clipperton ?
Lorsqu'il y a un projet scientifique, un appel d'offre est diffusé dans les organismes scientifiques (CNRS, IRD, Ifremer...). Ainsi, j'ai soumis mon projet à Jean-Louis Etienne. Mon travail sur les reptiles de Polynésie, ainsi que mes précédentes missions ont permis à mon projet d'être sélectionné. Il faut savoir se vendre et expliquer clairement son projet pour convaincre et espérer être retenu.
5. Comment étudiez-vous les échantillons ? Est-ce que vous en conservez (et comment), est-ce que vous en ramenez pour le Muséum National d’Histoire Naturelle?
Le Muséum National d'Histoire Naturelle garde toujours des échantillons des missions scientifiques. Bien entendu, le minimum d'échantillons est prélevé du milieu pour ne pas perturber l'écosystème. Ces échantillons sont conservés dans l'alcool, étudiés et inventoriés au Muséum National d'Histoire Naturelle. Les collections d'animaux et de végétaux du Muséum sont parmi les plus riches au monde et des scientifiques du monde entier viennent à Paris au Muséum pour étudier les animaux et les végétaux récoltés au cours de missions scientifiques historiques et actuelles.
Je vous invite même à venir me rencontrer au Muséum, dans mon laboratoire pour observer ces échantillons de retour de Clipperton, ainsi que quelques crabes vivants, également rapportés de l'îlot.
6. Avez-vous observé des serpents de mer ? Avez-vous effectué des plongées pour les observer ?
Les serpents marins n'ont pas été étudiés à Clipperton. Dans le Pacifique Ouest, il y a énormément de serpents marins (65 espèces de serpents marins répertoriées au monde). Plus on s'éloigne de l'ouest du Pacifique, et plus le nombre d'espèces de serpents diminue : 40 espèces aux Philippines, 20 puis finalement 1 seule espèce en Polynésie (Pelamis platurus). Ce dernier serpent est pélagique. Il vit en pleine mer en se laissant porter par les courants marins convergents qui transportent beaucoup d'algues, de poissons, d'organismes divers. La densité de serpents dans ces courants peut être très importante. Dans un couloir de 100 m de large et plusieurs km de long, on peut dénombrer 5000 serpents marins nageant près de la surface.
Un autre groupe de serpents que j'ai étudié en Nouvelle Calédonie est amphibie. Ces serpents vivent à terre mais vont chasser en mer des petits poissons. Nous avons pu les attraper à terre et on les a massé de l'arrière vers l'avant pour les faire recracher leurs proies. Plus de 300 murènes ont ainsi été récoltées par cette méthode dont 11 espèces nouvelles de murènes pour la science.
|
Pelamis platurus, le dos est noir et le ventre est jaune. La queue est aplatie, rayée de noir. |
Echanges sur les thèmes d’étude de chaque groupe d'élèves
7. JA : Avez-vous rencontré des scientifiques qui travaillaient sur les poissons, des ichtyologistes ?
Un des scientifiques du Muséum qui étudie les requins est allé à Clipperton. Il avait vu le film du Commandant Cousteau, tourné à Clipperton en 1980, montrant d'énormes groupes de requins marteaux. Ce spécialiste avait ainsi prévu de pêcher les requins avec le grand bateau, le Rara Avis pour échantillonner ces poissons de 50m à 300m de profondeur, les américains ayant fait de travail de 0 à 50m. Arrivé à Clipperton, ce chercheur n'a pu disposer que d'un petit bateau, inadapté à ses grosses pêches de requins. Il a néanmoins pu embarquer sur un thonier américain qui pêchait dans les eaux de Clipperton mais leurs filets étaient posés à très faible profondeur et les espèces récoltées étaient toujours les 3 mêmes. Un ichtyologiste particulier était peintre naturaliste. Il allait ramasser toutes sortes de poissons du lagon et les peignait tant qu'ils avaient encore leurs couleurs naturelles. Des inventaires de poisons ont été fait : 190 espèces inventoriées.
|
8. JRC : Concernant la biodiversité du lagon, y a t-il eu un travail en commun entre différents spécialistes (chimiste, zoologiste, botaniste…) pour comprendre le fonctionnement de l’écosystème ?
Le fait qu'il n'y ait pas de poissons dans le lagon sauf à une extrémité sera probablement expliqué par les données chimiques de l'eau, le pH, la salinité, les nitrates. Les conditions physico-chimiques permettront d'expliquer l'absence, la présence ou le développement de telle ou telle espèce. Ce sont les études intégrées qui sont actuellement privilégiées.
Concernant les lézards, il est important de savoir depuis combien de temps les oiseaux sont sur l'atoll, si leur densité est en augmentation ou en diminution. C'est important pour l'alimentation des lézards et pour l'évolution de leur régime alimentaire. Le guano exploité à Clipperton est une preuve de l'occupation ancienne des oiseaux.
Concernant la paléoclimatologie, si l'île a connu des périodes froides, le lézard tropical n'a pas pu résister à ce froid. Son implantation sur l'île peut alors être estimée grâce aux paléo-climatologues. Le but de cette expédition est de mettre toutes les données en commun et de montrer comment fonctionne l'écosystème. Ces chaînes alimentaires vont être appréciées et quantifiées par les études menées à Clipperton. Le but de ce travail est de publier un ouvrage commun sur toutes les données recueillies à Clipperton.
9. AC : Certains reptiles sont-ils nuisibles ? Pour qui ? Sont-ils venimeux, dangereux pour l’Homme ? Comment travaillent les chercheurs sur les rats ?
|
Voir la vidéo "Rats de Clipperton" |
De par le monde, certains reptiles sont nuisibles. En voici quelques exemples :
Le premier, la tortue de Floride, se vendait couramment en France il y a quelques années. Elle a été relâchée dans la nature à l'âge adulte et a concurrencé les espèces de tortues endémiques (dont la Cistude), et les a progressivement supplantées. C'est une espèce envahissante qui a éliminé sa concurrente, la Cistude, tortue qui fait partie de notre patrimoine biologique national.
Pour les serpents, il y a un cas encore plus dramatique. A l'ouest du Pacifique, en Micronésie, et en particulier sur l'île américaine de Guam le serpent brun arboricole a été introduit à partir du nord de l'Australie. Quand ce serpent est arrivé sur cette île, il a décimé de très nombreuses espèces très rares d'oiseaux. Certaines espèces ont définitivement disparu de la planète à cause de ce serpent, d'autres sont en cours de sauvetage à grand renfort de millions de dollars. Ce serpent a tellement pullulé sur cette île qu'il y a eu des coupures d'électricité car il faisait des courts-circuits sur les lignes à haute tension, des enfants sont morts envenimés par la morsure de ce serpent.
A Clipperton, les lézards n'ont pas de concurrence donc ils ne constituent pas une menace pour un lézard endémique. Les rats peuvent aussi faire disparaître des espèces en particulier des oiseaux dont ils se nourrissent des oeufs. Les chercheurs sur les rats ont étudié la répartition des rats sur l'îlot…et ils en ont trouvés un peu partout. |
|
10. : En conclusion, comment votre travail peut-il apporter sa contribution à une éducation à l’environnement et au développement durable ? A partir des échanges que vous avez pu avoir avec JLE, comment est-ce qu’il envisage ce concept d’éducation à l’environnement et au développement durable ?
L'exemple des reptiles est très pédagogique car à Clipperton, on trouve une espèce endémique et une espèce introduite. C'est un cas d'école. L'espèce endémique qui s'est adaptée, s'est transformée, est une preuve vivante d'évolution, de spéciation. L'évolution de ces espèces nous renseigne sur notre propre évolution, sur notre avenir, sur l'avenir de notre planète. C'est uniquement en étudiant les espèces -comment elles se forment, comment elles disparaissent- qu'on pourra mieux maîtriser la biodiversité.
Cette biodiversité que l'on recherche chez les animaux, nous renvoie à la conservation de notre propre identité et nos diversités régionales et culturelles. Chercher à uniformiser l'ensemble de la planète est un grand danger pour les espèces vivantes mais aussi pour l'homme. Il pourrait n'y avoir plus d'espèces envahissantes mais quelques espèces qui domineraient les autres en éliminant les plus fragiles. La réduction de la biodiversité engendrera des problèmes pour l'homme.
L'éducation à l'environnement doit passer par une vulgarisation des connaissances, avec une vocabulaire scientifique adapté au public et à l'étude des problématiques locales. Le goût de l'exotisme ne doit pas occulter la diversité régionale mais au contraire la renforcer. Les jeunes en contact avec leur environnement proche sont les acteurs du monde de demain et doivent agir avec responsabilité. Localement, vous avez énormément de choses à découvrir et il faut en avoir conscience.
|
Retour à la page d'accueil collège A. Camus